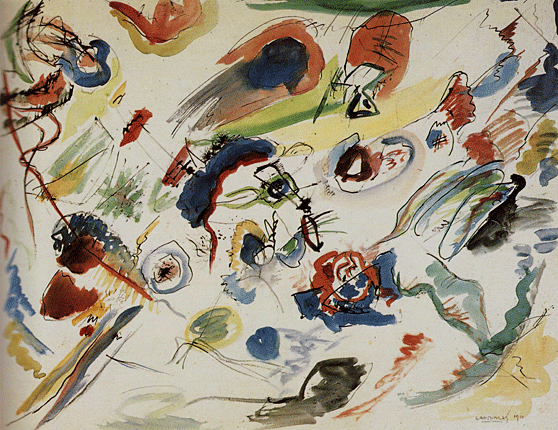
« Le rap a été un vecteur d’ascenseur social dans un monde où l’école républicaine est en crise. » Entretien avec Kévin Boucaud-Victoire.
16/09/2024
Kévin Boucaud-Victoire publie Penser le rap. De paria à dominant : analyse d’un phénomène culturel (L’aube, 2024). Nous revenons avec lui sur les grandes étapes de massification du rap, sur ses significations politiques et ses mutations récentes.
Votre livre commence par relater comment le rap s’est étendu à toutes les classes sociales, et s’est mué en phénomène culturel “majoritaire”, alors qu’il était né à l’origine au sein d’une contre-culture en butte contre les formes traditionnelles d’autorité. Quelles sont les grandes étapes de cette diffusion sociologique du rap, selon vous ?
La toute première, c’est la professionnalisation qui intervient entre la fin des années 1980 et le début des années 1990. Les premiers albums de NTM (Authentik), IAM (… De la planète Mars) et MC Solaar (Qui sème le vent récolte le tempo), tous les trois sortis en 1991 ont été de gros succès commerciaux. Comme l’écrit le journaliste Vincent Piolet, dans Regarde ta jeunesse dans les yeux (2015) : « Argent, médias, institutions : tel fut le triumvirat qui mit fin au statut de contre-culture du hip-hop. » En effet, dès lors le rap changeait de nature et s’intégrait à l’industrie musicale, et donc au système capitaliste, qu’il le veuille ou non.
Après la professionnalisation, il y a une phase d’une décennie de massification. Il y a énormément de projets qui sortent. Les succès commerciaux, les passages en radios, notamment par le biais de Skyrock devenu « premier sur le rap », etc. sont au rendez-vous. Emprisonné pendant cet âge d’or, Booba rappe : « Au fait, paraît que l’industrie du disque a saigné / Et que les négros arrêtent pas de signer » (La Lettre, 2000). Pour la petite anecdote, le rap est aidé indirectement dans cette phase par un gouvernement de droite. En 1994, la loi Carignon – du nom d’Alain Carignon, ministre de la Communication sous Édouard Balladur – entre en vigueur. Elle impose aux radios des quotas de diffusion : aux heures d’écoutes significatives, au moins 40 % du programme diffusé doivent contenir des morceaux créés ou interprétés par des artistes français ou francophones, dont la moitié provenant de nouveaux talents ou productions – c’est-à-dire qui ont moins d’un an d’existence. C’est grâce à cela que je rap va durablement se faire une place en radio.
Mais durant cette période le rap est très localisé. À quelques exceptions près, comme le groupe KDD, les MC sont tous issus de Paris et sa banlieue ou de Marseille. Les auditeurs, eux, sont moins uniformes, mais restent concentrés dans les zones urbaines défavorisées des métropoles, surtout dans celles de la banlieue parisienne. Le rap se diversifie géographiquement et socialement en plusieurs étapes. Il gagne d’abord les cités des villes moyennes, avec l’apparition de Din Records, dont Médine est la figure de proue, au Havre, Dosseh, demi-frère du rappeur Pit Baccardi, qui a eu un certain succès, à Orléans, et Niro, à Blois. Le succès, en 2009, d’Aurélien Cotentin, plus connu sous le blaze d’Orelsan, né à Alençon permet de toucher la classe moyenne de la « France périphérique ». Enfin, en 2011, grâce aux Rap Contenders, tournoi de clashs, les bobos peuvent s’identifier au groupe 1995, auxquels appartiennent Nekfeu et Alpha Wann. Entre le milieu des années 2000 et le mitan des années 2010, nous avons vu apparaître des rappeurs de tous les coins de France et issus de toutes les classes sociales. Tous les jeunes peuvent donc potentiellement se reconnaître dans le rap
Est-ce qu’on ne peut pas malgré tout distinguer différents types d’écoute du rap selon la classe sociale concernée, et ce d’autant plus que la classe bourgeoise est souvent caractérisée par l’éclectisme ou l’omnivorisme de ses pratiques musicales – ce qui nuancerait peut-être l’idée d’une diffusion sociologique du rap ? Par ailleurs, ne peut-on pas distinguer une écoute savante du rap (plus attachée au “flow” des morceaux, et aux modalités d’écriture) répandue chez les classes aisées, et une écoute plus populaire du rap (qui s’attache davantage à la fonction du rap, et aux thématiques abordées)[1] ?
Complètement. Aujourd’hui le rap n’est plus cantonné aux cités. Et pire, on voit même des auditeurs railler le « rap de tess ». C’est comme si un fan de reggae se moquait du mouvement rastafari. Reste que le rap demeure avant tout la musique de cette classe sociale. C’est elle qui en a défini les codes en France ou qui a adapté les codes états-uniens. Les écoutes ne sont donc évidemment pas les mêmes, entre le jeune de cité, pour qui le rap fait partie de son identité culturelle et dont les textes font échos – parfois – à son vécu, et le bourgeois qui en écoute pour s’encanailler ou jouer au bad boy. Cela peut avoir des conséquences concrètes. Par exemple, il est possible que les textes plus « cailleras » et violents soient pris au second degré par un jeune bourgeois. Ou que dans le meilleur des cas, cela lui fasse fantasmer un monde qui est loin du sien. Pour un jeune de cité, cela peut faire échos à son vécu ou à celui de proche et peut exercer une vraie influence – évidemment le rap ne serait pas le seul facteur.
Il y a bien évidemment une écoute plus savante du rap. C’est vrai dans tous les domaines : un cinéphile ne regarde pas une œuvre, même populaire, de la même manière que le grand public. Cela marche aussi dans le rap. Et les classes qui ont plus de capital culturel ont tendance soit à justifier leur goût en les intellectualisant ou à y mobiliser leurs connaissances acquises dans d’autres, là où des individus plus modestes vont écouter du rap parce que cela appartient à leur bain social et culturel.
Concernant le rap, on note une forme de paradoxe : il semble s’être diffusé parmi les groupes sociaux, mais le genre est par ailleurs fortement délégitimé dans l’arène médiatique, et régulièrement discrédité par le discours politique. Quant au RnB, il cumule plusieurs disqualifications : jugé commercial et “consommable”, féminin[2], il semble caractériser un “capital symbolique négatif”, pour reprendre une expression de Toril Moi[3]. Le rap n’est-il pas sujet à des dynamiques sociales contradictoires ?
Ça dépend, le rap a pu avoir le soutien du ministère de la Culture et a pu être promu par des politiques de la ville. Jack Lang, ministre de la Culture emblématique de la gauche a toujours montré de l’intérêt pour le rap – jusqu’à se pointer à la cérémonie des Flammes en 2023 – et Rachida Dati, qui occupe aujourd’hui ce poste a participé à l’émission DVM Show. Et fait surprenant, Marion Maréchal a même admis apprécier plusieurs rappeurs, même si cela n’apparaîtra jamais dans ses discours politiques. Côté médias, le rap a pu être soutenu par une certaine presse bourgeoise comme Canal + ou les Inrocks. Souvenez-vous qu’en 2008, c’est sur le plateau de Michel Denisot que NTM se reforme.
Maintenant, c’est vrai que le rap a souvent mauvaise presse chez les élites. Cela peut se comprendre, vu que les rappeurs n’ont jamais hésité à attaquer frontalement les responsables politiques ou les médias, ils ne se sont pas aidés. Mais malgré ces précisions, je vous rejoins. Si le rap est aujourd’hui écouté dans toute la jeunesse, a acquis même une certaine légitimité auprès d’une partie des classes supérieures, il reste dans l’imaginaire collectif la musique des « classes dangereuses » ou victime de mépris de classe. Quant au R&B, s’il a toujours eu du succès commercial, il n’est clairement pas pris au sérieux, sûrement effectivement parce qu’il est perçu comme trop féminin.
Quels effets sociaux et politique a eu le rap à ses débuts, en tant qu’il était une contre-culture remettant en question certaines figures d’autorité ? A-t-il permis une forme d’émancipation, pour celles et ceux dont il portait la voix ?
On peut dire que la phase vraiment contre-culturelle du rap, en France, c’est entre 1983 et 1990. À ce moment, le rap est une discipline mineure du hip-hop, qui comprend le djing, la danse ou encore des arts graphiques. Il est alors pratiqué principalement dans des lieux confidentiels ou alternatifs et ne se vend pas encore. En 1990, la sortie de la compilation Rapattitude change la donne. Durant cette période, le hip-hop est trop marginal pour réellement émanciper les cités.
Mais le rap a peut-être été émancipateur dans les débuts de sa phase commerciale. Il a donné l’espoir d’une représentation, d’une opposition au système, à une frange de la population, voire lui a fait prendre conscience de certaines oppressions. Il a peut-être été également porteur de déceptions. Par exemple, dans son dernier album, Suicide social, en 2009, le rappeur Le Vrai Ben – devenu depuis le chanteur Benjamin Paulin et qui, il est vrai, n’est pas issu des classes populaires – rappait à propos du discours antisystème des MC : « T’as 15 ans, t’y crois ; t’as 20 ans, t’y crois ; t’as 30 ans tu t’aperçois qu’ces cons se foutent de toi » (La vérité) ou encore : « J’croyais qu’les rappeurs voulaient changer ce système qui nous exploite, ils voulaient juste rentrer en boîte » (Règlement de compte).
Ensuite, le rap a aussi poussé des jeunes à ouvrir des dictionnaires, à tenter des rimes, découvrir ce que sont des allitérations ou des assonances, dans le but d’écrire des textes de rap. Et enfin, il a été un vecteur d’ascenseur social, dans un monde où l’école républicaine est en crise. C’est ce qu’exprime Kery James, lorsqu’il rappe : « Qui aurait pu penser que le R.A.P. pourrait donner une chance aux ghettos français ? »
Vous évoquez une “dépolitisation” du rap, ces dernières années. Or si l’on pense à l’engagement de certains dans le collectif Justice pour Adama, au texte “L’odeur de l’essence” d’Orelsan ou même au morceau “No pasaran” appelant à voter contre le RN, de nombreuses têtes d’affiches ont pris des positions politiques. Par ailleurs, dans notre numéro sur les classes populaires, un membre du comité de rédaction revenait sur l’oeuvre de Rohff et concluait qu’elle illustrait “l’intégration sociale progressive des banlieues populaires à la société nationale” – intégration dont le rap a été un des vecteurs[4]. Plutôt que de voir dans le rap une montée de “l’ultra-individualisme”, ne peut-on pas y voir une nouvelle forme de réflexivité, à la fois éclairante et émancipatrice, sur le statut des banlieues ? Le rap français est-il si désengagé de la cité ?
Dans mon livre, j’écris que la cause antiraciste est une des rares qui poussent encore les rappeurs à se mobiliser. Donc rien de surprenant au soutien au Comité Adama ou à l’opposition au RN.
Ensuite, individualisme et intégration ne s’opposent pas. L’individualisme est une des valeurs dominantes de notre société, de plus en plus composée de « monades isolées repliées sur elles-mêmes », plongées dans les « eaux glacées du capitalisme », pour reprendre les termes de Karl Marx. Aujourd’hui, nous devons nous construire nous-même, hors de toute attache communautaire – ce qui n’empêche pas de nouvelles formes de communautarisme propre à notre société –, nous sommes appelés à nous déraciner, l’engagement à long terme est de plus en plus faible, etc. En cela, les rappeurs sont effectivement intégrés et sont bien français, même lorsqu’ils sont issus de l’immigration. Peut-être que le rap a été un de ces vecteurs.
Pour ce qui est de la dépolitisation, ce n’est pas qu’une impression personnelle, mais quelque chose qui confirmé par l’analyse statistiques. Ainsi, le site de datas RapMinerz souligne que si dans les années 1990, 12% des morceaux évoquent les « flics », ce n’est plus le cas que pour 2% d’entre eux, en 2020. Sur la même période, le mot « ghetto » a reculé de 9% à 2% et le mot « ministère » de 1,6% à 0,9%. À l’inverse, l’outil statistiques développé par le site Rap Genius, RapStats, prouve que les textes des rappeurs parlent de plus en plus de voitures, d’argent ou de « salopes ».
Pour rester quand même positif, je dirais quand même les rappeurs font un vrai travail sur la langue française et ont des références françaises qui côtoient des références issues de la mondialisation, avec les mangas, par exemple, ou certaines séries et films américains. Finalement le rap français a épousé les caractères nationaux de son époque. Peut-être même plus que le rock, par exemple, qui ressemble souvent à un pur décalque, voire une parodie, du rock anglo-saxon.
Vous montrez que les rappeurs sont le fruit de la société de consommation – sans néanmoins adhérer à l’explication caricaturale selon laquelle le rap se serait finalement “vendu” au capitalisme (critique que véhicule souvent la pensée conservatrice pour mieux discréditer le rap). Votre position est plus nuancée : quels rapports le rap entretient-il avec le capitalisme, selon vous ?
Déjà comme toute la pop musique, et plus largement toute la culture de masse, le rap répond à une logique de marchandisation et de profit. Mais dire cela ne suffit pas. Sur la forme, le rap, au moins jusqu’au début des années 2010 – c’est beaucoup moins le cas maintenant –, est pris dans une contradiction. Il se présente comme antisystème, comme le porte-voix des dominés. C’est évidemment vrai pour le rap underground, mais aussi pour le mainstream. En 91, dans Le Monde de demain, NTM rappe : « Mon appel est sérieux / Non ne prend pas ça comme un jeu / Car les jeunes changent / Voilà ce qui dérange / Plus question de laisser passer en attendant que ça s’arrange / Je ne suis pas un leader / Simplement le haut-parleur / D’une génération révoltée / Prête à tout ébranler. » Quatre ans plus tard, le célèbre duo de Seine-Saint-Denis scande, dans Qu’est-ce qu’on attend : « Dorénavant la rue ne pardonne plus/ Nous n’avons rien à perdre, car nous n’avons jamais eu… / À votre place je ne dormirais pas tranquille / La bourgeoisie peut trembler, les cailleras sont dans la ville. » IAM, l’autre tête d’affiche des années 1990, rappe, en 97, dans Nés sous la même étoile, morceau qui dénonce les inégalités sociales : « Pourquoi fortune et infortune ? / Pourquoi suis-je né / Les poches vides pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes ? » Les premiers ont aussi rappé Ma Benz, sont vite devenus des artistes branchés et Kool Shen est même devenu joueur de poker professionnel. Ils se font traiter par Fabe dans Des durs, des boss… des dombis ! (1997) de « mythomanes, qui jouent les pyromanes aux Bains-Douches. » C’est moins net du côté d’IAM, mais on peut souligner qu’Akhenaton a collaboré avec Adidas et participé à une campagne publicitaire de Coca-Cola.
Mais ces contradictions touchent la majorité des rappeurs. Ärsenik, groupe génial qui a popularisé le slogan : « Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position ? », a été le meilleur ambassadeur de Lacoste en banlieues. Même Kery James qui se pose en sage, et dont les textes sont souvent intéressants, ne propose finalement que l’entrepreneuriat comme solution, c’est-à-dire une meilleure intégration dans le capitalisme. Plus largement, les rappeurs ont participé à populariser, en plus de Lacoste, Nike, Adidas et même plus récemment le Capri-Sun ! Je ne leur jette pas la pierre. Ce ne sont ni des théoriciens, ni des militants. Ce sont des gens qui subissent le capitalisme, et s’en posent donc en critique, tout en ayant un imaginaire dominé par lui, et qui finalement souhaitent profiter des bienfaits – parfois illusoires – qu’il peut prodiguer aux plus fortunés, une fois sortie de la pauvreté. En réalité, ils ressemblent à leur époque. Enfin, cette contradiction que je pointe tente à s’estomper : avec la dépolitisation, ne reste que l’imaginaire capitaliste ! Là encore, ils sont les enfants de leur temps !
[1] Nous reprenons une analyse de Stéphanie Molinero, Les Publics du rap. Enquête sociologique, Paris, L’Harmattan, France, 2009, pp. 179-183.
[2] Karim Hammou, Marie Sonnette-Manouguian, « Chapitre VI. 40 ans de musiques hip-hop en France : (il)légitimation, institutionnalisation et patrimonialisation », in Karim Hammou (éd.), 40 ans de musiques hip-hop en France, Paris, Ministère de la Culture – DEPS, « Questions de culture », 2022, pp. 173-211.
[3] Toril Moi, “Appropriating Bourdieu: Feminist Theory and Pierre Bourdieu’s Sociology of Culture”, New Literary History, vol 22, n°4, 1991, pp. 1017-1049. Utilisé par Karim Hammou, Marie Sonnette-Manouguian, op. cit.
[4] Milo Lévy-Bruhl, « ROH2F, ou la synecdoque d’une dynamique d’intégration », Germinal, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 64-71.





