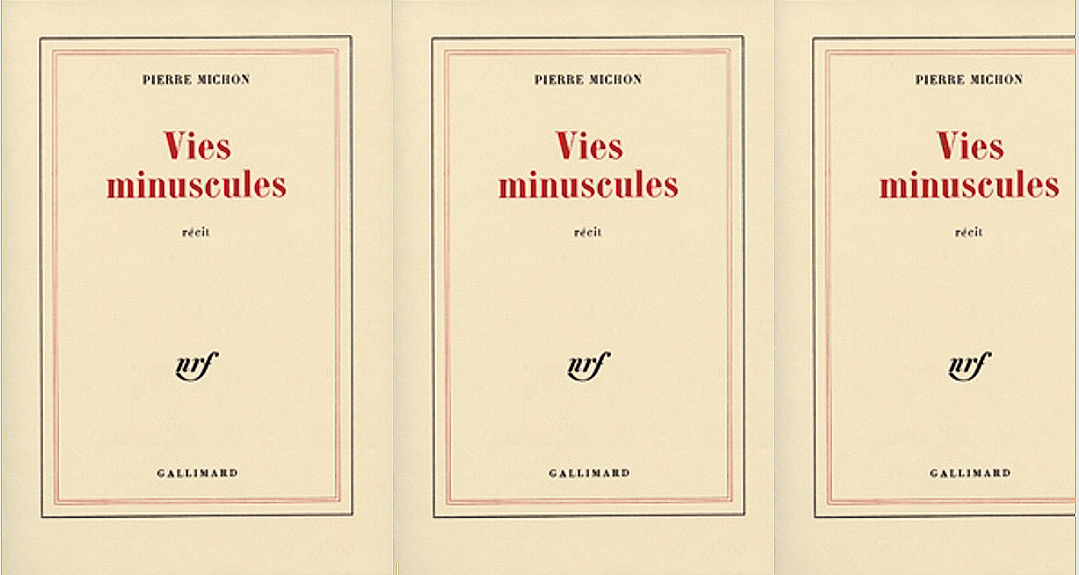
La « place » : retour sur les Vies minuscules de Pierre Michon
29/12/2021
Kathia Huynh, doctorante en littérature française à l’université d’Orléans, revient ici sur les Vies minuscules de Pierre Michon à travers la notion de place, concept situé à l’interface entre sociologie et littérature : la plupart des « vies » exposées par Michon retraceraient ainsi les parcours d’individus qui ont ou prennent conscience d’occuper une certaine « place » dans le monde, qui est peut-être avant toute chose une position dans la langue.
Pierre Michon, auteur des Vies minuscules (1984), où sont racontées dans un style de haute volée les « vies » de huit humbles petites gens qui ont croisé son chemin, et d’une série d’essais et de récits (Vie de Joseph Roulin, Rimbaud le Fils, La Grande Beune, Mythologies d’hiver, Trois auteurs, Corps du roi, Les Onze…) est sans l’ombre d’un doute une figure centrale de la littérature française contemporaine. Comme d’autres auteurs et autrices de sa génération (Pierre Bergounioux, Richard Millet, Annie Ernaux), sa carrière d’écrivain part de la province, et tout un pan de son œuvre revient sur cette origine et sur le poids des déterminismes, pour réaliser tout à la fois un hommage et une mise à distance. Si Pierre Michon a baigné dans un contexte intellectuel qui l’a mis au contact des sciences sociales (la sociologie de Bourdieu, la philosophie de Foucault, le structuralisme de Barthes, la psychanalyse de Freud), si son expérience elle-même rejoint leurs objets et si sa démarche littéraire, celle du « récit de filiation »1, se nourrit de leurs acquis, on ne peut pas dire qu’elles soient l’intertexte majeur de son œuvre : ses maîtres restent Flaubert et Faulkner, et ce qu’il dit du rapport de ce dernier à Freud2 est assez révélateur de sa propre position par rapport aux sciences sociales, qu’il n’ignore pas et auxquelles il est même sensible, mais qu’il est amené à dépasser dans l’œuvre.
Cette ambivalence mérite d’être explorée dans les Vies minuscules, au moyen d’une notion située à l’interface entre sociologie et littérature, celle de « place », empruntée à Annie Ernaux : la plupart des « vies » retracent les parcours d’individus qui ont ou prennent conscience d’occuper une certaine « place » dans le monde. Cependant, l’ensemble de critères au croisement desquels cette « place » se construit – géographiques, sociaux, culturels, économiques, familiaux – s’efface pour révéler le facteur identitaire réellement pertinent aux yeux de Michon. La « place » se définit comme position dans la langue (française, officielle, littéraire), et, dans les drames imperceptibles qui sont racontés, c’est toujours par rapport à elle que les héros minuscules, et partant l’écrivain, prennent position et se pensent.
*
Récit originel, celui de « Pierrot »3 le fou qui, d’écrivain qui n’écrit pas, accède au statut d’auteur, les Vies minuscules de Pierre Michon sont aussi des récits de l’origine, commune aux huit petites gens dont la vie est contée et à leur biographe, celle qui les lie à la terre, à la province, à la ruralité. Dans les entretiens collectés dans Le Roi vient quand il veut, Michon reconnaît à ces attaches une manière d’inscription dans la langue : tantôt il signale qu’à celui qui vient de Mourioux, dans la Creuse, « la langue, le bel écrit […] [sont] refusés », tantôt il se distingue de Céline en ce qu’il est de naissance urbaine, « un enfant de la ville, et [lui] non », et admet que « [s]e greffer sur cette langue-là, ce parler Parisot, qui n’est pas le [s]ien » serait vain. Toutefois, Michon, « né en 1945 aux Cards » selon la formule consacrée par les journalistes, pour riposter à cet État-civil sans cesse brandi pour situer son œuvre, met aussi un frein aux lectures qui auraient la fâcheuse tendance de réduire son identité à cette origine rurale : aux racines terriennes sont souvent substituées un enracinement dans la langue : « mais je crois bien n’avoir plus d’autres racines que la lettre », « je n’ai pas non plus de racines rurales. Mon vrai terroir, c’est l’école : j’ai appris la littérature par la bouche des instituteurs », répète-t-il. C’est donc bien que le facteur géographique ne suffit pas, aux yeux de Michon, pour comprendre la « place » qu’il occupe dans le champ de production contemporain – sinon, quelle serait sa différence par rapport à Bergounioux dont il a souvent été rapproché, parallèle qu’il ne nie pas mais qu’il invite à établir prudemment, sans se laisser piéger par l’illusion rurale4 ? Mutatis mutandis, il ne saurait suffire pour comprendre la « place » occupée par ses héros de province, alors même que leur destin semble borné aux frontières de leur terre natale. Par cette attention à ce qui, dans l’existence menée par ces êtres, déborde le cadre géographique et le déterminisme culturel, Michon réussit à éviter la « casserole régionaliste » dont il avoue avoir eu peur.
Pour Pierre Michon, l’ancrage primordial plutôt que premier, le seul qui, au fond, vaille, est celui de l’homme dans la langue, la belle langue, « langue-mère » en permanence comparée ou substituée à la « terre-mère ». C’est dans le rapport à la langue, d’elle, d’après elle et vers elle, que se construit la « place » des vies minuscules, et à travers elles, celle de Michon lui-même. Le parallèle avec La Place d’Annie Ernaux, publié chez Gallimard en 1983, soit un an avant les Vies minuscules, n’est pas fortuit. Ce concept aux résonances sociologiques, dont le sentiment diffus a conditionné l’existence du père d’Annie Ernaux et qu’elle veut rendre lisible par un récit d’hommage et d’enquête, permet de dégager une interrogation tout aussi prégnante dans les Vies minuscules, quoiqu’Ernaux et Michon incarnent deux pôles antithétiques sur le spectre stylistique (« l’écriture plate » d’un côté, de l’autre le « “beau style” » d’après un journaliste ou les « grandes orgues » selon Michon, non sans une certaine ironie). Dans les positions et les trajectoires des êtres que le texte de Michon met en lumière, le sentiment de domination et d’illégitimité est entièrement reversé dans le domaine linguistique et littéraire. Ainsi, quoiqu’analysables à travers un prisme sociologique, parce que leur référent s’y prête, ces vies apparaissent comme les supports d’une quête littéraire et d’une réflexion plus générale sur les rapports de l’homme à la langue.
La terre comme la langue
Pour définir la « place » occupée par les huit personnages des Vies minuscules, il ne s’agit pas d’écarter totalement le conditionnement géographique, dans la mesure où la ruralité fait office de malédiction pour ces « gens qui naissent avec de grands appétits, qui auraient pu devenir de grands poètes, de grands évêques, s’ils n’étaient pas nés dans un lieu rural ». De cette province donnée comme archaïque et reculée, Michon inscrit en creux les « palabres patoises » de ses grands-parents, culturellement dominées par la langue légitime, la « Belle Langue » de Racine ; le village devient le nom de l’angoisse d’illégitimité qui frappe l’un des frères Bakroot qui, face aux textes, sent qu’il n’est que « Roland Bakroot, de Saint-Priest-Palus » ; c’est enfin « l’amour » de la terre, du « lopin », qui en est aussi la « haine », qui fonde d’abord l’identité de Toussaint Peluchet, père d’Antoine Peluchet.
Cependant, on aurait tort d’en faire l’unique critère définitoire. Sans aller jusqu’à dire, comme le fait Michon, que « la province n’a guère […] de pertinence », le déterminisme rural vient à être dépassé par ce qui constitue le véritable drame de l’identité selon Michon. C’est dans un rapport conflictuel à la langue, structure qui possède et impose ses propres hiérarchies, que les vies minuscules ont l’intuition de la place qu’elles occupent dans le monde, cherchent à y prendre place et se singularisent. La « Vie des frères Bakroot » est à ce titre exemplaire. Réécriture du mythe des frères ennemis, elle retrace le destin de Rémi et Roland Bakroot, Abel et Caïn de province, de leurs années au pensionnat à leur entrée dans le supérieur, jusqu’à l’enterrement du premier. Si cette « vie » atteint aux dimensions de la légende, elle prend aussi l’allure d’un récit anti-déterministe, qui évacue le poids de l’hérédité et du milieu au profit de l’événement que constitue la rencontre avec les livres5. Nés de parents « peu notables », « paysans semblables à tant d’autres », ruraux, élevés dans le même pensionnat, Rémi et Roland empruntent toutefois des chemins opposés, jusqu’à s’inscrire dans l’existence suivant des modalités inverses, parce qu’ils ne partagent pas le même rapport à la langue. Pour mieux l’invalider par la suite, Michon se plaît d’abord à souligner leur naissance provinciale par une expression identique : « Roland Bakroot, de Saint-Priest-Palus. » est repris en écho par « c’est qu’il [Rémi] était de Saint-Priest-Palus, lui aussi. L’analogie érotique fait ensuite saillir leur différence : chez Roland, la métaphore filée de la « belle robe […] trop agrafée » de l’écriture à soulever pour découvrir le secret des grands auteurs se retourne chez Rémi en « jupettes » que « laissaient froisser » des filles bien réelles. Le parallélisme sert à faire saillir l’écart entre leur place respective : l’aîné, Roland, qui s’est enfermé dans les livres au point qu’ils lui « [tiennent] lieu » de monde, cherche désespérément à embrasser le corps du texte, tandis que le cadet, Rémi, a pris le parti des choses, qui s’exprime par son penchant pour les collections de toutes sortes. Sur cette distinction fondamentale, présence ou absence de racines dans la langue, Michon délimite la « place » qui incombe à chaque frère à l’aide d’une métaphore grammaticale. Il relègue ainsi l’aîné dans le cercle du « passé simple » et le cadet dans celui du « présent », en conférant aux verbes un aspect et une valeur irréductibles à la grammaire : ces temps ont un sens existentiel. L’opposition recoupe d’abord une vieille distinction entre temps du récit et du discours, entre usage littéraire et quotidien, entre registre soutenu et courant. Mais rapidement, le « passé simple » devient l’autre nom d’une errance imaginaire, dans un « pays qui n’existait pas », d’une place vide hors du monde6qui débouche sur une disgrâce sociale : Roland « échoue dans une fac de lettres, à Poitiers ». Au contraire, le « présent invincible » embrasse toute la matérialité du monde, « feuilles qui bougent » et « soleil qui réapparaît ». Le « présent rieur » est le mode d’être de celui qui est le « contemporain des choses ». Et parce qu’il maîtrise les règles du jeu social, « ces règles farfelues et tyranniques qui donnent la maîtrise du présent », ce dernier grimpe le long de l’échelle sociale jusqu’à intégrer Saint-Cyr.
Par ailleurs, à de nombreuses reprises, la province est moins un espace qu’un code linguistique et une position dans la langue. Dans « Vie d’Antoine Peluchet » le lieu rural autour de la famille Peluchet n’est qu’une cristallisation des choses du monde en mots, la géographie qu’un lexique relatif :
« […] que les mots sont vastes, qu’ils sont douteux, que l’herbe-au-gueux s’appelle aussi la clématite, que les cinq herbes de saint Jan, dont on fait des croix clouées aux portes des étables, sont, aussi bien qu’herbe saint Roche, saint Martin, sainte Barbe ou saint Fiacre, molène, scabieuse et cirse : que le patois n’est pas coextensible à l’univers, et le français pas davantage […] ».
Et c’est aussi à travers la langue qu’est exprimée la « place » occupée par chaque parent Peluchet après le départ du fils. Le drame familial s’actualise, encore une fois, dans une partition verbale. Désormais marginalisé et désancré, plus occupé à se balader dans les champs avec Fiéfié, à la fois « bouffon élisabéthain » et « prophèt[e] », qu’à labourer sa terre, le père rêve la vie de son fils à travers le nom « Amérique », qui surgit comme un fantasme issu de Manon Lescautet de l’atlas trouvés dans la chambre d’Antoine. « Résumant toutes les fictions possibles et l’idée même de fiction », ce mot reflète la nouvelle identité de Toussaint : à force d’affabulation, il devient à la fois absolument fou (à la fin du récit, il divague, croît être allé à Bâton-Rouge alors qu’il n’a jamais mis les pieds hors de son village) et pleinement Père, car par là, il devient enfin « auteur des jours du fils ». En face, la mère, « dont le nom d’Amérique jamais ne pass[e] les lèvres », invisible et figée dans le quotidien de la province, « marmonn[e] sans cesse les noms de sainte Barbe, sainte Fleur et saint Fiacre » : collée aux bornes du monde connu, elle ne peut que ruminer les mots qui en forment la texture même.
Parvenus, imposteurs, dominés : marginaux par la langue
Les Vies minuscules proposent une série de trajectoires dont les possibles, la courbe, la réussite ou l’échec, dans les études sociologiques, sont en général évaluées à l’aune d’une multitude de facteurs – géographiques, économiques, culturels, politiques, sexuels, sociaux, symboliques, etc. Tout en faisant affluer dans ses récits la trace d’un discours sociologique, en particulier la conscience d’une structuration de l’espace par des systèmes de hiérarchies et de dominations, Michon met en sourdine la pluralité des déterminismes et s’attache à accorder la primauté à la seule conscience linguistique ou littéraire, qui, à ses yeux, subsume les autres critères, les résume et les dépasse tous. On s’intéressera ainsi à trois types sociaux qui permettent la rencontre entre Michon et les sciences humaines, mais qui surtout indiquent la voie par laquelle il s’en sépare : le parvenu qu’est André Dufourneau, l’imposteur qu’est Roland Bakroot, et le dominé qu’est le Père Foucault. Tous se découvrent marginaux, mais cette marginalité est entièrement reversée dans l’espace symbolique de la langue, comme l’écrit Jean-Pierre Richard : cet écart est « une position nouvelle établie dans le champ du symbolique, dans le rapport que chaque héros minuscule entretient avec sa manière de parler, ou de se taire, avec les mots de son propre langage7 ». De là, on verra comment la sociologie des parcours s’efface derrière une mythologie de la langue.
Pendant son service militaire, André Dufourneau comprend que « la hiérarchie des langues calque une hiérarchie sociale8 ». À Paris, il fait le douloureux apprentissage de la domination symbolique : « il entendit de jeunes hommes […] ; c’était la langue qu’il tenait d’Élise, mais elle paraissait une autre tant ses indigènes en connaissaient les pistes, les échos, les roueries. Il sut qu’il était paysan ». De cette conscience d’occuper les derniers rangs émerge la volonté de parvenir(« ceux qu’on […] appelle “parvenus”). Ce désir prend un pli collectif, puisque Dufourneau fait sien le fantasme colonial de sa génération, glorifié par la propagande étatique en tant que promesse d’aventures et de fortune. De prime abord, la différence linguistique enclenche le rêve d’ascension sociale, elle est le moyen d’une prise de conscience du social. Cependant, Michon inverse la balance : sous sa plume, la colonisation de l’Afrique se transforme en conquête de la langue, et la suprématie qu’il aspire à y exercer n’est qu’un effort pour fuir « ce langage qui l’humiliait » puis renverser à son avantage les dominations symboliques :
« et je ne désavouerais pas davantage ce qui fut, j’imagine, le mobile majeur de son départ ; l’assurance que là-bas un paysan devenait un Blanc, et, fût-il le dernier des fils mal nés, contrefaits et répudiés de la langue-mère, il était plus près de ses jupes qu’un Peul ou un Baoulé […]. »
L’ambition est le moyen d’accéder à la langue légitime, qui ne peut cependant se réaliser que de façon compensatoire, en tentant de substituer l’inégalité raciste entre homme blanc et noir à son avantage, à la hiérarchie entre indigène et métèque de la langue, qui le voue à la marginalité. Il n’est pas anodin que pour représenter l’opulence fantasmée du continent africain, Michon cite « Royauté » de Rimbaud (« du côté des jardins de palmes, chez un peuple fort doux ») : que la luxueuse place visée par le parvenu soit évoquée par le biais d’un auteur qui incarne l’idée même de littérature traduit ce qui est véritablement recherché dans cet espace. L’aspiration à la richesse n’est que le masque d’une espérance plus profonde, celle de trôner au cœur de la belle langue.
Roland Bakroot, ensuite, peinant à affronter les textes d’auteurs que pourtant il adore, souffre à leur égard d’un profond sentiment d’imposture. En des termes plus sociologiques, on pourrait décrire cette « indignité » et ces « impostures » comme les résultantes d’un sentiment d’illégitimité, né de l’intériorisation des hiérarchies. L’imposteur se confine alors dans un discours de perpétuelle infériorité et de remise en cause de sa légitimité à être et à dire face à un objet, que la culture dominante a posé comme légitime, réservé à une élite soigneusement définie, et que l’individu a, conséquemment, érigé en inaccessible.
Il y avait dans son exégèse forcenée comme une panique d’interprétation, une douleur a priori, la terrible certitude d’errer ou d’omettre, et, quoi qu’il fît pour qu’on n’en crût rien, une foi amère en son indignité : un ignoble fantassin suisse, un de ces médiocres disciplinés par qui mourut le Téméraire, et qui, trop sûr de l’enfer à lui promis, se serait dissimulé parmi les glorieuses ombres bourguignonnes attendant leur part céleste, voilà ce que Roland pensait être parmi les livres. Et voilà pourquoi il taisait habituellement ses lectures, c’est-à-dire ses impostures.
Significativement, l’imposture ne connaît de trêve que lorsque Roland contemple un Kipling illustré, cadeau de son professeur de latin : « il s’attardait sans doute sur les images qu’il jugeait plus proches de lui-même, plus conformes à ce qu’il serait un jour, les fraternelles images de chute ». L’axe infériorité/supériorité est rabattu sur un paradigme littéraire, fondé sur une opposition entre langue écrite des classiques – celle des « vrais [auteurs] dont toujours on est indigne » et de ceux qui ont l’autorité suffisante pour l’incarner, comme Achille, professeur au nom illustre et dont les pas scandent les pieds des alexandrins –, et illustrations d’une littérature dédiée à la jeunesse – réservées aux enfants (et étymologiquement, infans signifie « celui qui ne parle pas ») et à ceux qui ne peuvent s’élever à la hauteur de la lettre.
Enfin, le père Foucault est un cas extrême à tous points de vue. Après une vive altercation en sortie de bar qui tourne en bagarre, Michon atterrit à l’hôpital de Clermont-Ferrand et y fait la rencontre du père Foucault, qui refuse énigmatiquement d’être transféré dans un centre de soin parisien pour traiter son cancer de la gorge. Une première explication, stéréotypée, prêtant au paysan un « enracinement, obtus et sentimental » dans sa terre, est immédiatement battue en brèche : « Il n’avait pas davantage d’attaches avec un terroir imaginaire ». Puisque la crainte du « déracinement » ne conditionne pas les choix du père Foucault, c’est donc que son entêtement a d’autres raisons. Et Michon de mettre son lecteur sur la piste, en dénudant les hiérarchies à l’œuvre dans l’hôpital, en cela microcosme social : « j’usais sans doute du même bavardage chatoyant, aguicheur et vide, que les puissants qu’elles [les infirmières] servent sans vergogne », infirmières « serviles » envers « les doctes en blouses blanches » et « vitupérines » « envers les plus humbles des malades ». À ceux qui domptent la langue incombe la place de dominants ; en miroir, ceux que les aide-soignantes traitent en dominés n’en ont pas la maîtrise. Par conséquent, en livrant cet aveu poignant, « “Je suis illettré” », le père Foucault révèle la « honte » qui lui vient de la conscience de sa domination par la langue, et son refus d’être transféré dans un hôpital parisien se comprend comme incapacité à la subir en permanence, d’autant plus lorsqu’elle est exacerbée par la capitale. L’hégémonie parisienne, prégnante dans les romans du XIXe siècle, fondée sur une opposition Paris/Province qui résulte d’un croisement de facteurs sociaux, culturels, économiques et symboliques, est ici surtout traitée par Michon suivant l’angle du langage seul. À Paris, « cette ville où les murs mêmes étaient lettrés, historiques les ponts et incompréhensibles l’achalandage et l’enseigne des boutiques », tout signe est linguistique ; et lorsque le père Foucault pense à la place qu’il occuperait dans la capitale, c’est à l’aune de son illettrisme qu’il l’évalue : « Que serait-il entre leurs mains, lui qui ne savait pas lire le journal ? ». Placé devant une alternative entre la vie et la mort, qui signifie pour lui avouer et endurer sa domination symbolique, ou expier cette « monstruosité » et échapper à la honte, le père Foucault préfère se laisser mourir, ne supportant pas la place que lui réserve « l’absence de la lettre ». Illettré, négatif même de la langue, le père Foucault est le dominé par excellence, qui montre combien la conscience des hiérarchies linguistiques est fondamentale dans l’évaluation de sa place et dans la pensée de soi.
Si l’approche sociologique se laisse dépasser, c’est parce que Michon détourne ses « vies » de leur terreau social pour les faire servir à d’autres fins. Avouant déformer ses sources et décoller du réel dans ses paratextes ou au sein même du texte9, Michon produit du récit sur le mode de l’éventuel, voire de l’irréel, pour combler les blancs inhérents aux légendes transmises oralement par sa famille, mais aussi pour transformer un devenir social en recherche de l’absolu littéraire. Ces récits d’ascension, d’illégitimité et de domination deviennent les supports tangibles d’une quête invisible et quasi mystique, celle d’une incorporation dans la langue même. Le fantasme incestueux d’André Dufourneau qui veut aller « au plus près [des] jupes » de la « langue-mère », au point de l’« épous[er] », est désir de fusion avec celle que la métaphore érige déjà, par le tabou, en intouchable et en inaccessible. Plus explicitement encore, dans « Vie du père Foucault », le biographe prend l’illettrisme de son double au mot : sa honte à lui est, littéralement, d’être il-lettré, de n’être pas fait dans sa chair de lettres et de mots :
« […] il eût fallu que la partie invisible fût, elle aussi, polie de mots, parfaitement gelée comme l’inaltérable diamant d’un dictionnaire. Mais j’étais vivant ; et puisque ma vie n’était pas un verbier, puisque toujours m’échappait la lettre dont j’eusse voulu des pieds à la tête être constitué […] ».
Dans les Vies minuscules, atteindre cette « place » idéale, dans la fusion avec la langue, se solde par un inévitable échec. Tous sont condamnés à rester en marge de la belle langue : Roland Bakroot ne communique jamais avec les Auteurs « Là-Haut » et « demeur[e] dans leur interminable silence » tandis que Rémi au tombeau devient, ironiquement, « un livre, à présent ». Dufourneau, dont « les phrases patoises rev[iennent] sans qu’il y song[e] épouser [s]es pensées », est ramené à son origine, en dépit de ses déclarations et de ses postures.
Dans le même temps, la mort place ces héros au cœur même de la langue, puisque l’abolition du corps est la condition de l’invention de la légende, ce que disent exemplairement les vies de Dufourneau, d’Antoine Peluchet ou de la « petite morte », sœur défunte de l’écrivain, qui se déploient pleinement sur fond d’absence. Le choix d’« installer ces vies dans l’écart le plus grand entre leur référent minable et les grandes orgues dont [Michon] jou[e] pour rendre compte de cette nullité […] et dans le même mouvement la dépasser et la magnifier » pourrait être le moyen de leur redonner « place » au cœur de la langue qui les a ignorés et écrasés, et, par là, de trouver sa propre place : « alors ils sont sauvés, et celui qui en parle est sauvé avec eux ». Ainsi de Roland Bakroot, transfiguré par une comparaison au capitaine Achab et par un alexandrin final, « Et moi seul j’échappai, pour venir te le dire ». Michon reprend la traduction que Giono fait de Moby Dick, où Melville lui-même réécrit un épisode de Job : cet étourdissant tourbillon intertextuel permet au frère indigne de côtoyer dans l’espace du texte les grands auteurs, et même d’atteindre ce qui est, aux yeux de Michon, le berceau et le sommet de la littérature occidentale, la Bible. Et ainsi, aussi, de Dufourneau : le « poncif », « “J’en reviendrai riche ou mourrai” », auquel le vouaient sa morgue de parvenu qui dédaigne les « mots humblement approximatifs » et son ignorance de paysan dont le « matériel langagier » est « trop réduit », accède quand même au « “littéraire” ». Michon joue sur un effet de syllepse : l’adjectif désigne à la fois tout type de production écrite, jusqu’à la plus mauvaise, et le canon consacré, afin de mettre en lumière les deux « places » simultanément occupées par Dufourneau. La place, d’abord, qui était sans doute réellement la sienne : médiocre usager de la langue, il puise avec forfanterie dans un « répertoire » de formules topiques, dans un bric-à-brac qui donne un titre de noblesse de pacotille. Mais aussi la place profondément littéraire queMichon lui octroie. Il est posé en modèle de l’écrivain, parce qu’il rejoint par sa fuite en avant l’imaginaire de la poésie rimbaldienne et qu’il va même jusqu’à « ressemble[r] » à un écrivain comme Faulkner. Il est aussi modèle pour l’écrivain, qui comme lui n’est finalement qu’un « explorateur » de « bibliothèques » pour qui « l’Afrique » est « l’écriture ».
Ainsi, à tous ceux qui ont échoué à prendre la place du « roi », le biographe, par un texte de restauration, les réinscrit dans « le royaume des Lettres »10.
Et Michon ?
Les Vies minuscules échappent enfin à l’approche sociologique parce qu’elles font office de scénographies « obliques »11de l’écrivain, qui voit en ses personnages des doubles ou des frères, selon une symétrie avouée : « Mais parlant de lui, c’est de moi dont je parle », « Moi aussi, j’avais hypostasié le savoir et la lettre en catégories mythologiques […] ; j’étais l’analphabète […] ». La dramaturgie de la place se comprend donc à l’aune d’une genèse auctoriale et de la formation d’un projet littéraire.
Cependant, il ne faudrait pas se hâter de déduire de cet autoportrait diffus l’idée que l’obsession pour la « place » de l’individu dans le monde, obtenue par une lutte avec la langue, n’est que l’écho d’une hantise propre au seul écrivain Michon. Comme il le dit lui-même, on aurait tort de lire les Vies minuscules comme le monologue autocentré d’un je-auteur qui se contemple au miroir de la langue : sur le « noyau » du je, « personne du monde qu[’il] conna[ît] le mieux », Michon « greffe de petites variations de surface » afin de prendre en charge « l’autobiographie du genre humain ». La conscience de la « place » occupée par la langue et à partir de laquelle tout un chacun s’appréhende et appréhende le monde en retour est certes hypertrophiée dans le cas de l’écrivain, mais elle appartient à tout être. En cela, il ne nous semble pas que le drame du langage traversé par les héros des Vies minuscules en fasse, comme le pense Jean-Pierre Richard, des « êtres romanesques », des « personnages »11, relevant du pur domaine de la fiction. Il s’agirait plutôt de distinguer d’une part la littérarisation, qui est le moyen d’une panthéonisation, à laquelle, indéniablement, procède Michon, et d’autre part l’effort de mise au jour d’une interrogation et d’une angoisse liées à la langue, partagées, selon Michon, par tout le genre humain. Plus qu’un obstacle ou une épreuve, ce qui en ferait un épisode romanesque, le drame du langage est une façon d’être au monde. Ou, pour reprendre une dernière fois Annie Ernaux, citant dans l’épigraphe de La Honte (1997) L’Invention de la solitude de Paul Auster : « Le langage n’est pas la vérité. Il est notre manière d’exister dans l’univers. »
Notes
- Selon la terminologie de Dominique Viart, « Filiations littéraires », Revue des lettres modernes, 1999, p. 115-139.
- Le Roi vient quand il veut[2007], Paris, Albin Michel, 2016, p. 161 : « Un jour, on posa à Faulkner une question sur Freud, et il fit cette réponse : “On parlait beaucoup de Freud quand j’étais à La Nouvelle-Orléans. Mais je ne l’ai pas lu. Shakespeare ne l’avait pas lu non plus. Je doute que Melville l’ait lu et je suis sûr que Moby Dick ne l’avait pas lu.” C’est à la fois le bluff le plus éhonté, parce que évidemment il avait mis le nez dans Freud, et en même temps il dit vrai. De même, Michon a lu Freud, puisque la « Vie d’André Dufourneau » reprend les mots et les concepts d’un article de Freud, « Le roman familial des névrosés », mais fait comme s’il ne l’avait pas lu en n’en faisant jamais explicitement mention, même sous la forme d’une citation non attribuée. Le Roi vient quand il veut rassemble trente entretiens donnés par Michon depuis 1984. Toutes les références qui y seront faites seront désormais directement intégrées dans le corps du texte (R).
- Vies minuscules[1984], Gallimard, collection « folio », 2020, p. 195. Toutes les références aux Vies minuscules(VM) se feront désormais directement dans le corps du texte.
- Comme en atteste cet extrait d’un entretien donné par Pierre Michon (R, 142) : « Comment êtes-vous devenu écrivain ? Pierre Bergounioux, auquel vous avez dédié “La Danseuse”, texte consacré à Cingria, explique qu’il a connu trois vies : une vie rurale, une vie de lecteur puis une vie d’écrivain, avec l’espoir de s’en délivrer. Partagez-vous cette expérience ? C’est une des expériences qui nous sont communes, à Bergounioux et à moi, quoique pour moi ce soit moins tranché et qu’il y ait des chevauchements multiples entre les époques. C’est que je n’ai pas la forte opiniâtreté méthodique de Bergounioux. Bien sûr il y a l’enfance rurale, c’est-à-dire ce qui me fonde en indignité et en désir de renverser cette indignité en son contraire. Mais pour le reste… c’est moins successif que ça. […] ».
- Michon avoue dans un entretien du Roi avoir inventé de toutes pièces le conflit littéraire de la fratrie Bakroot, et en revient, lorsqu’il s’agit d’évoquer ses modèles, à une explication platement sociologique. Cet ajout vaut pour preuve, selon nous, du fait que Michon veut faire de la langue littéraire un critère de différenciation et d’individuation. Inexistante dans la vie de ses modèles, elle se dote d’une valeur cardinale dans le récit qu’en fait le biographe (R, 304) : « Y avait-il vraiment ce combat entre la littérature et la réalité entre eux ? Absolument pas. Leur modèle est un mélange des frères Bakerodt et des frères Riva. Les frères Riva, il y en a un qui a fait Saint-Cyr, comme mon Bakeroot [sic]. Les Bakerodt se battaient entre eux, mais ils se battaient entre eux parce que c’étaient des fils de prolos finis, et qu’ils étaient vraiment bruts de décoffrage, aucun des deux n’aimait Flaubert, ça c’est de l’invention pure ».
- À chaque mention du « passé simple » se met en place une isotopie du « vide » : « [Roland] s’enfonçait de plus belle dans le tourbillon de ces passés que nul n’a jamais vécus, ces aventures comme arrivées à d’autres et qui pourtant n’arrivèrent à personne. » ; « Dès lors, sa vie s’était fourvoyéedans les passés simples » ; « Quand il levait la tête, quand les beaux passés simples s’effondraient […] » (VM, 125. Nous soulignons).
- Jean-Pierre Richard, « Servitude et grandeur du minuscule », dans L’État des choses. Études sur huit écrivains d’aujourd’hui, Paris, Gallimard, 1990, p. 92.
- Sylviane Coyault-Dublanchet, La Province en héritage. Pierre Michon, Pierre Bergounioux, Richard Millet, Paris, Droz, 2002, p. 44.
- Par exemple, dans « Vie d’André Dufourneau » : « Sa vocation fut l’Afrique. Et j’ose croire un instant, sachant qu’il n’en fut rien, que ce qui l’y appela fut moins l’appât grossier de la fortune à faire qu’une reddition inconditionnée entre les mains de l’intransitive Fortune ; qu’il était trop orphelin, irrémédiablement vulgaire et non né pour faire sienne les dévotes calembredaines que sont l’ascension sociale, la probation par un caractère fort, la réussite acquise qu’on doit au seul mérite ; qu’il partit comme jure un ivrogne, émigra comme il tombe. J’ose le croire. » (VM, 19)
- Jean-Pierre Richard, « Servitude et grandeur du minuscule », art. cit., p. 106.
- Jean-Pierre Richard propose de voir dans les Vies minuscules« une sorte d’autobiographie oblique et éclatée », « Servitude et grandeur du minuscule », art. cit., p. 87
Ancienne élève de l’ENS de Paris et agrégée de Lettres modernes, Kathia Huynh prépare depuis 2018 à l’Université d’Orléans une thèse sous la direction d’Aude Déruelle intitulée « Le Poignard et le Scalpel. Balzac et le romanesque ». Ses articles et ses communications portent sur ce sujet (« Le romanesque du rien dans Le Cousin Pons » ; « Une ténébreuse province. Transposition structurale et enquête éthique dans Le Curé de Tours et Pierrette« ). Elle a également rédigé la partie consacrée à Illusions perdues au programme des CPGE dans l’ouvrage Khâgnes 2022 aux éditions Atlande.





