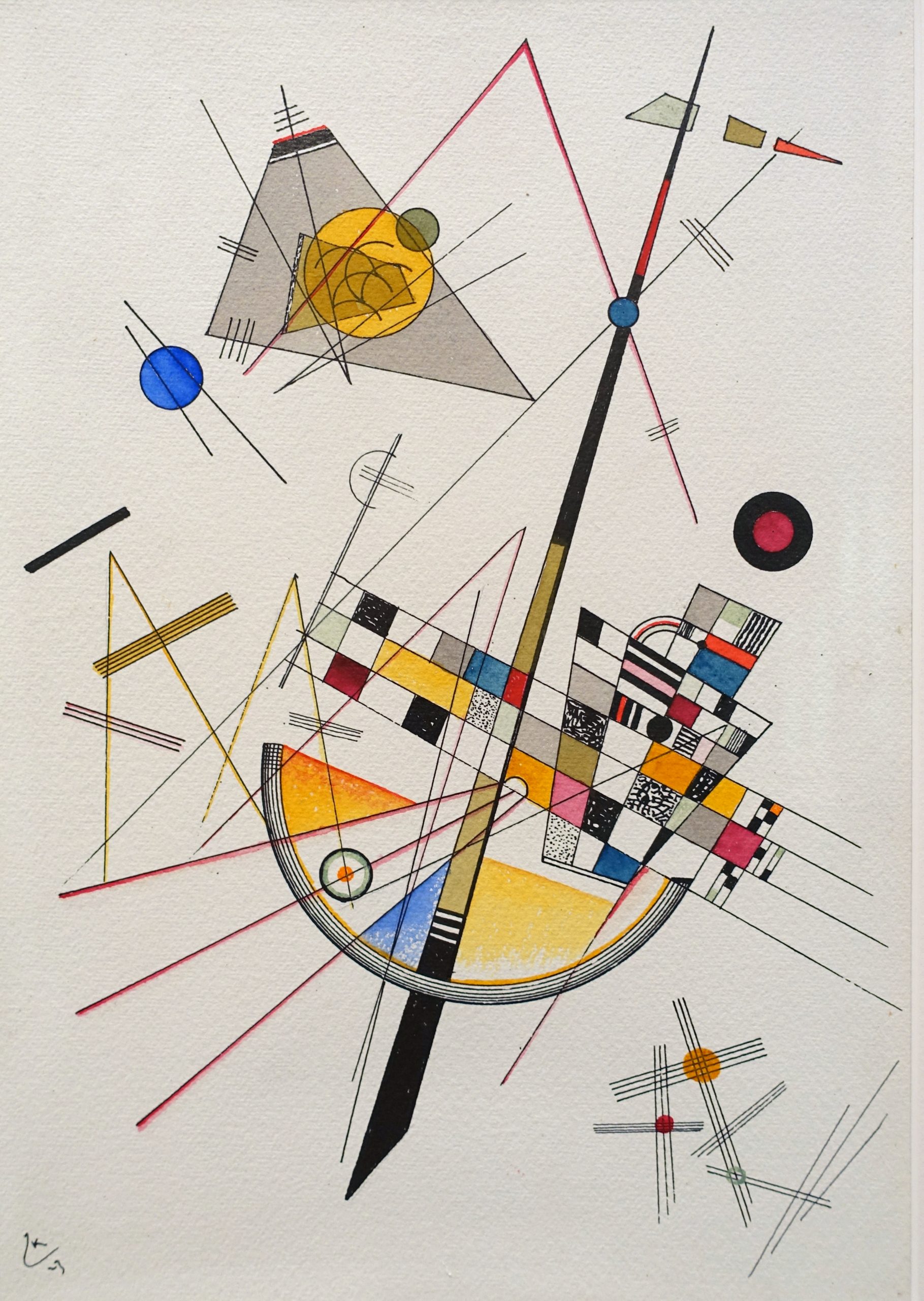
La transition sociale-écologique : au-delà de la croissance, sans croissance ?
10/05/2021
La croissance fait de la résistance
La contestation de la croissance comme mesure pertinente du bien-être humain et horizon juste et rationnel des politiques publiques n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui dans la sphère académique et les cercles de décision internationaux. En atteste l’accueil qui lui est désormais fait dans les revues scientifiques les plus influentes[1] et dans nombre d’institutions-clé du débat économique et écologique mondial[2]. La montée en puissance de cette critique participe de la libération des récits – porteuse d’autant d’espoir que de périls – observée partout sur la planète après la longue nuit silencieuse de l’impérialisme économique, qui touche inexorablement à sa fin.
Mais l’imaginaire de la croissance résiste encore et entend même se réinventer à la faveur du grand tournant écologique du vingt-et-unième siècle qui vient de commencer dans la douleur avec l’année 2020. Deux justifications se font ainsi entendre, par exemple en Europe, pour maintenir le Produit intérieur brut (PIB) et son expansion au centre des horizons économiques et sociaux alors que la transition écologique s’engage enfin.
La première est de nature économique et consiste à soutenir que pour financer les investissements nécessaires à la transformation écologique des appareils productifs à travers le monde (la « modernisation écologique »), à commencer par leur indispensable décarbonation, il faudra de la croissance (repeinte en vert pour la circonstance) qui deviendra endogène quand ces investissements de modernisation engendreront à leur tour une expansion du PIB. On relie souvent cette justification économique au retour de la puissance publique (réarmée sur le plan industriel, voire planificatrice), dans le but de la rendre désirable aux oreilles de celles et ceux qui déplorent son affaiblissement supposé au cours des trente dernières années. La « croissance verte » comme raison d’être du « retour de l’État ».
Cette ligne argumentative est problématique à bien des égards. D’abord, compte tenu du mix énergétique mondial actuel (à 80% fossile, comme il y a quarante ans) et du réchauffement planétaire déjà acquis (1,2 degré en 2020), chaque unité supplémentaire de croissance du PIB se traduit par des dégâts de plus en plus coûteux sur la biosphère et donc pour le bien-être humain, de sorte que cette croissance pourrait bien ne pas avoir le temps de devenir verte : son coût écologique exponentiel annulera puis inversera ses gains attendus à moyen terme avant même que ceux-ci ne puissent se matérialiser. De manière moins dramatique, on comprend intuitivement que plus la croissance sera forte, plus vite il faudra accélérer la baisse des émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à se compliquer encore une tâche déjà passablement compliquée. Mener la transition écologique avec le PIB comme boussole revient à tenter de se saisir avec les mains d’un objet que l’on repousse toujours plus loin avec le pied.
Il y a à cet égard un monde de différence, du point de vue des politiques économiques, entre viser la sobriété énergétique, carbonique ou plus généralement matérielle (la baisse des volumes consommés de ressources naturelles) et viser l’efficacité énergétique, carbonique ou matérielle (par exemple atténuer le changement climatique en réduisant l’intensité énergétique de la croissance). Si les premiers indicateurs acceptent les réalités biophysiques comme contraintes, les seconds en font abstraction au moyen de la croissance du PIB, qui fait office d’écran idéologique placé devant le défi écologique.
Les données 2018 du Global Carbon Project montrent ainsi que si les émissions de CO2 annuelles ont doublé en volume sous l’effet de la croissance du PIB mondial depuis 1970, l’intensité carbonique du PIB a été quant à elle divisée par plus de deux, de 650 grammes de CO2 par dollar en 1970 à un peu plus de 300 en 2018 : l’illusion de l’efficacité carbonique est parfaite. Elle est aussi, à terme, mortelle. De même, il n’y a dans les faits aucun découplage entre le PIB et l’empreinte matérielle[3] depuis 1970 au plan mondial, pas plus qu’au plan européen[4]. Le PIB fait donc doublement écran, sous la forme de la croissance et sous celle du découplage (placé au cœur de tous les projets de « modernisation écologique » ou éco-moderniste, comme le projet de Pacte vert européen).
Plus avant, vouloir développer « la croissance verte » a pour effet d’oblitérer le débat sur les moyens et la finalité de la transition écologique. S’agissant des moyens, la priorité, avant tout investissement supplémentaire, doit être de réduire à zéro les subventions aux énergies fossiles, tellement considérables au plan mondial (et européen) qu’elles conduisent aujourd’hui, en dépit des fiscalités existantes, à un prix négatif du carbone. De même, il est parfaitement à notre portée, notamment en France comme on le verra plus loin, de concevoir des politiques fiscales progressives sociales-écologiques à PIB constant.
« La croissance verte » brouille de même les finalités de la transition écologique, laquelle n’a pas pour objet la modernisation de l’appareil productif, la « compétitivité » mondiale ni même la reconquête de la souveraineté ou la restauration de la puissance publique, mais la préservation du bien-être humain menacé d’autodestruction à moyen terme (2040-2050) et des principes de justice sociale qui structurent les sociétés humaines, en somme l’hospitalité partagée de notre planète. Ce sont ces objectifs de justice dynamique qui doivent informer à chaque étape les politiques publiques pour ne pas faire office, in fine, de variables d’ajustement. Dans cette perspective, il paraît bien plus judicieux de puiser dans le stock d’inégalités de revenu accumulé ces dernières décennies plutôt que d’augmenter le revenu national pour en consacrer la partie que l’on pourra et que l’on saura à des investissements de décarbonation. En clair, il ne s’agit pas, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’augmenter le revenu national, mais de réduire l’inégalité de sa répartition, ce qui change tout du point de vue de l’orientation des politiques publiques. C’est un trait caractéristique de la focalisation sur la croissance que de faire l’impasse sur la question de la justice : le PIB est un écran idéologique placé devant l’exigence de justice. En s’y fiant, on passe totalement à côté de la question centrale de la transition non pas écologique mais sociale-écologique : l’articulation entre justice et soutenabilité, comme moyen et comme fin.
Donc, s’il nous faut de toute urgence définir et détailler une stratégie de développement axée sur le bien-être humain dynamique, la transition juste paraît bien plus adaptée, au sens social comme environnemental, que la croissance verte[5].
La seconde justification écologique de la croissance relève de la psychologie sociale et de la tactique politique : comme il ne faut surtout pas braquer les décideurs publics (réputés prudents) et les investisseurs privés (réputés sensibles) en abandonnant trop manifestement les horizons économiques auxquels ils sont habitués, il faudrait faire mine de croire encore en la croissance pour gagner leur soutien et subtilement amorcer le changement souhaité avec leur consentement plutôt que de passer grossièrement en force. Ce serait par exemple la justification du mot d’ordre de la Commission européenne au sujet de son Pacte vert (Green Deal) présenté en décembre 2019 comme une « nouvelle stratégie de croissance » dans le but d’amadouer les Etats membres les plus réticents à s’engager dans la transition écologique.
Cette justification est encore moins convaincante que la précédente : tout indique que la tiédeur et l’insincérité des engagements écologiques des États sont un frein puissant à la transition des attitudes et des comportements des consommateurs et des producteurs. Plus, en se payant de mots, on contribuera en fait à prolonger l’inertie des structures sociales et mentales économiques du vingtième siècle, plus on retardera la transition écologique dans les faits et plus, en retour, cet atermoiement sera coûteux économiquement et socialement.
Qui plus est, subordonner comme le fait la Commission européenne la transition écologique à la croissance économique se traduit très concrètement par le choix d’objectifs de politique publiques, comme le découplage PIB-CO2 en production, qui emporte des effets adverses pour la transition écologique (effets qui seraient à l’inverse favorables si l’ambition européenne était par exemple de découpler le bien-être humain des émissions de CO2 en consommation[6]).
La « croissance verte » comme d’ailleurs la « croissance inclusive » ne sont pas des indicateurs, ce sont au mieux de bonnes résolutions : si on continue dans les faits de compter sur l’expansion du PIB pour les tenir alors même que celui-ci ne peut par construction ni mesurer les inégalités ni les dommages environnementaux, il faut alors admettre que l’on espère soit les atteindre par chance, soit que l’on puisse après coup contenir les dégâts de la croissance sur ces objectifs. Il s’agit en tout état de cause d’une stratégie de développement par accident pour le moins hasardeuse.
Les indicateurs, comme les élections, ont des conséquences. Le terme « indicateur » est aride et rebute sans doute la majorité des gens, mais son étymologie est très parlante : c’est l’index, le doigt qui montre la direction à suivre. Un indicateur économique, c’est une direction que choisissent de suivre les responsables de la politique économique. Des chemins différents peuvent y mener, mais on ne peut pas faire semblant de suivre une direction pour en suivre en réalité une autre, surtout quand ces deux directions sont éloignées l’une de l’autre et que l’on est censé par ses orientations guider des groupes humains pour des décennies. C’est ce qui laisse, à raison, beaucoup d’observateurs sceptiques sur la sincérité des ambitions écologiques européennes, en particulier si l’on ajoute à la nébulosité du découplage, la nébulosité de la « neutralité carbone ».
Continuer à faire croire que la croissance économique, qui n’est en tout état de cause qu’un objectif intermédiaire des politiques publiques, permettra par ruissellement d’atteindre les objectifs finaux que sont le bien-être humain, sa résilience et sa soutenabilité, revient à continuer de faire de la croissance économique l’horizon indépassable de ces politiques. Et c’est une erreur de perspective : la croissance empêche d’atteindre ces objectifs finaux. Il en va de la croissance comme du gaz de schiste : c’est une stratégie de diversion qui entrave la transition en prétendant l’engager à petits pas.
La croissance résiste, certes, mais ces résistances sont de plus en plus fragiles et de moins en moins défendables : on prolonge dans l’ordre imaginaire l’identification entre croissance, bien-être humain et progrès social tout en se trompant lourdement dans l’ordre empirique sur la réalité des bienfaits sociaux et environnementaux de la croissance.
On postule ainsi une loi d’airain entre croissance du PIB et emploi, mais cette loi est sans cesse invalidée (au cours de la décennie 2000 aux Etats-Unis[7], au cours des dix dernières années en France[8], au cours des vingt dernières années dans la zone euro[9] y compris l’année 2020, pour tous les pays de l’OCDE depuis dix ans[10], etc.) tandis que les modèles de transition énergétique fondés sur la sobriété font la démonstration que l’on peut faire totalement abstraction du PIB pour évaluer les importantes créations d’emplois ou les considérables gains de bien-être humain (notamment sanitaires) associés à une décarbonation totale de l’économie française ou mondiale (voir les scénarios Négawatt pour la France et ceux de l’équipe de Mark Jacobson à Stanford).
De même, comment nier que la croissance du PIB est rendue caduque par celle des inégalités et ne profite réellement qu’à une part minuscule de la population qui se réduit comme peau de chagrin (faut-il rappeler que la mirifique croissance américaine, qui a vu le PIB des Etats-Unis être multiplié par 3 entre 1993 et 2018, a été captée à 85% par les 10% les plus riches du pays) tout en induisant un coût écologique et donc humain astronomique de plus en plus tangible pour une large part de l’humanité (le scénario d’une forte croissance économique nourrie par les énergies fossiles conduit selon la modélisation de l’Institut Pierre Simon Laplace à un réchauffement de 6 à 7 degrés à la fin du 21ème siècle) ?
Au fond, les choses sont assez simples : le début du vingt-et-unième siècle est marqué par trois crises connexes dont le PIB et sa croissance ne peuvent, par construction, rien nous dire. Parce qu’il agrège les composantes de la valeur ajoutée, le PIB cache la crise des inégalités sociales. Parce qu’il efface les consommations intermédiaires pour ne comptabiliser que la valeur monétaire, il masque les crises écologiques. Parce qu’il passe sous silence la manière dont la valeur ajoutée est accumulée, il éclipse la crise de la démocratie.
Mais comment sortir de la croissance pour engager la transition sociale-écologique ? La première manière consiste à se donner de nouveaux horizons communs, par exemple la « pleine santé »[11]. La seconde consiste à imaginer non seulement de nouvelles finalités à la coopération sociale, mais aussi à se passer de croissance du PIB pour y parvenir. Est-ce seulement possible ? Et si oui, au moyen de quelles politiques publiques ?
Trois stratégies imbriquées pour soutenir la transition sociale-écologique
Les tentatives pour décrédibiliser la sortie de la croissance ne manquent pas. L’argument le plus paresseux consiste à opposer de manière manichéenne la croissance à « la décroissance », laquelle est érigée en régression anthropologique. On fait fi ce faisant de la pluralité des décroissances (réduction des volumes consommés, baisse du PIB, baisse des consommations individuelles, post-matérialisme, réinvention des modes de vie, etc.) et de la pluralité des sorties de la croissance (décroissances, post-croissance, transition du bien-être, etc.).
Une critique apparaît cependant plus sérieuse : un certain nombre de voix s’élèvent pour s’inquiéter des conséquences sociales de l’épuisement de la croissance. Elles craignent que l’on ne puisse pas se passer de la croissance comme instrument de financement des politiques sociales, même si on voulait la dépasser comme horizon social. Il convient de répondre aussi précisément que possible à cette légitime inquiétude, entendue notamment dans les milieux syndicaux.
Les États providence sont-ils essentiellement, comme le soutient par exemple Ian Gough, des « États de croissance » (growth states) ? On peut sérieusement en douter, en montrant par exemple que : l’État providence s’est développé en Europe à deux moments clés, la fin du dix-neuvième siècle et l’après Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de faible croissance ; que l’austérité sociale a été mise en place sur ce même continent européen à la faveur d’une croissance forte ou modérée, ce qui invalide l’idée que la croissance est une condition nécessaire aux politiques sociales ambitieuses ; que l’état des inégalités sociales influe sur les possibilités de production de sorte que le niveau des revenus est déterminé en partie par la qualité des politiques sociales, ce qui renverse le sens de la causalité entre production et répartition ; que les paramètres structurels, démographiques, technologiques, sociaux et sociétaux, qui déterminent le niveau et la dynamique des dépenses sociales pèsent bien plus lourd que la croissance du PIB dans leur soutenabilité de long terme [12].
Plus fondamentalement, il importe de comprendre que le PIB et sa croissance ne forment que la richesse superficielle des Nations mais n’en sont pas la cause profonde. « L’indicateur » central chez Adam Smith n’est pas le PIB mais la productivité du travail, dont résulte en partie la croissance économique mais dont l’expansion dessine un horizon de politique publique très différent de celle du PIB, cet horizon faisant des politiques publiques de santé et d’éducation des priorités, alors qu’elles sont marginalisées dans les systèmes économiques actuels obsédés par la croissance du PIB fondé sur la finance, l’industrie numérique ou les énergies fossiles et qui comptabilise très mal, comme on le sait, la qualité de l’éducation et de la santé.
Rappelons ici que l’accroissement de la productivité du travail ne sert pas à s’enrichir mais à ne pas passer sa vie à travailler : elle permet la baisse du volume des heures de travail à niveau de vie constant, ce qui libère la vie humaine du fardeau du labeur. La finalité de la productivité du travail est donc le bien-être humain, pas la croissance.
On peut plus généralement soutenir l’hypothèse inverse de celle qui prévaut généralement s’agissant de l’augmentation indéniablement spectaculaire des niveaux de vie au vingtième siècle : c’est l’augmentation encore plus spectaculaire des niveaux de santé et d’éducation qui soutient l’accroissement de la productivité du travail et in fine celle du PIB par habitant, qui apparaît rétrospectivement et pas seulement prospectivement comme un indicateur superficiel du développement humain au regard de ces déterminants profonds (pour les données qui soutiennent ces propos, voir Laurent 2019[13]).
L’effet de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis offre une illustration frappante de la différence entre production et bien-être. La production de soins aux Etats-Unis représente aujourd’hui 3 000 milliards de dollars, plus que toute l’économie française, ce qui en fait sans doute la plus grande industrie de l’économie mondiale. Cela ne nous dit rien de la qualité des soins dans le pays parce que le système de santé américain, tel une pyramide de Ponzi, est engagé depuis des décennies dans une course à la rentabilité financière qui voit le prix de toutes les prestations, traitements et médicaments artificiellement gonflé (alimentant le PIB au passage). L’inefficacité économique du système de santé américain saute aux yeux : il coûte deux fois plus cher en moyenne que dans les pays comparables avec des résultats nettement plus mauvais (espérance de vie, mortalité infantile, décès évitables, etc.). C’est précisément cette inefficacité qui explique que le système de santé américain soit si coûteux (inefficacité qui s’est traduite par un recul de l’espérance de vie entre 2014 et 2017 sous l’effet de la crise des opioïdes alimentée par la cupidité des laboratoires pharmaceutiques et par une perte de 1,15 année, effaçant dix années et demi de gains d’espérance de vie en 2020, sous l’effet du Covid).
Autant le système de santé américain alimente la croissance économique, autant il affaiblit la santé des Américains et donc à terme leur productivité du travail : il finira donc par épuiser les sources de la croissance économique de long terme que sont la productivité et la population.
La vraie question n’est donc pas de savoir si l’on peut mener à bien une sortie de la croissance sans croissance mais de comprendre que des politiques axées sur le PIB peuvent conduire à amoindrir la productivité du travail et donc, en retour, la croissance elle-même. Ce n’est pas seulement que l’obsession de la croissance ne garantit pas le bien-être humain, c’est qu’elle ne garantit pas non plus la croissance future.
Mais peut-on dire au moins qu’il faut de la croissance économique pour financer les politiques sociales, comme il en faut pour financer les politiques écologiques ? Insistons à nouveau sur le fait que la croissance joue un rôle marginal comparé aux paramètres structurels des politiques sociales. Le niveau des dépenses sociales dépend d’indicateurs beaucoup plus structurels que la croissance du PIB : productivité du travail, revenus d’activité, partage de la valeur ajoutée, démographie, comportements d’activité, etc. Il faut donc agir directement sur ces paramètres si on entend vraiment stabiliser les politiques sociales à long terme, sans compter sur un illusoire effet de ruissellement.[14].
Comme le dit clairement le Rapport du Conseil d’orientation des retraites de décembre 2020, qui compare un certain nombre de régimes dans différents pays développés : « Le niveau et l’évolution de la part des dépenses de retraite dans lePIB dépendent des contextes démographique (en particulier de la structure par âge) et économique (productivité du travail, partage de la valeur ajoutée et taux d’emploi) dans lesquels ils s’inscrivent. Ils dépendent également des règles propres à chacun des systèmes de retraite (notamment l’âge de départ à la retraite qui conditionne le taux de retraités parmi la population âgée et les règles de calcul des pensions) ». Ces paramètres et ces règles, qui répondent à des principes de justice, sont bien plus importants que la croissance du PIB.
Pour ne parler que du contexte économique (que le COR distingue des « facteurs démographiques » et des « règles du système »), l’organisme public souligne que : « Le contexte économique qui conditionne la soutenabilité à long terme d’un système de retraite est le reflet de la productivité du travail, des taux d’emploi et du partage de la richesse dans les différents pays étudiés. » Il n’est même plus acquis que la croissance du PIB soit encore un bon indicateur de la capacité fiscale des États : la financiarisation du PIB, l’optimisation et l’évasion fiscale de revenus pourtant comptabilisés comme contribuant au PIB, la régressivité d’ensemble du système fiscal français, la déconnection entre PIB et revenus des ménages[15], etc. plaident pour l’usage d’indicateurs plus fins en la matière.
C’est précisément le sens de la première stratégie de transition sociale-écologique libérée de la croissance, celle de court terme, qui consiste à utiliser le potentiel des inégalités économiques en introduisant des fiscalités écologiques progressives socialement compensées. On peut utiliser deux assiettes fiscales différentes à PIB constant : la consommation de CO2 et le patrimoine.
En taxant le patrimoine, on taxe la croissance inégalitaire passée sans besoin de croissance supplémentaire. De même, l’épargne considérable accumulée en France peut être orientée vers des politiques sociales-écologiques ou des investissements publics de sobriété énergétique sans besoin d’augmenter le revenu national pour financer des investissements publics.
Mais on peut également directement « taxer les inégalités », c’est-à-dire faire reposer des fiscalités sociales-écologiques sur les inégalités de revenu et d’empreinte carbone, à condition de partir d’un diagnostic lucide sur l’état des inégalités. La fiscalité environnementale est en effet un cas d’espèce d’une politique écologique qui peut conduire à aggraver les injustices en prétendant vouloir les corriger. Mais concevoir et mettre en œuvre des politiques de transition juste est à la fois simple, peu coûteux et indépendant de la croissance. On peut ainsi demain instaurer en France une taxe sociale-écologique progressive sur le CO2 (Berry et Laurent, 2019)[16] qui diminuera les dommages environnementaux en réduisant les inégalités sociales sans besoin de croissance supplémentaire. On pourra par la même occasion réduire drastiquement les subventions aux énergies fossiles pour dégager des moyens considérables sans croissance supplémentaire.
La deuxième stratégie consiste à financer la transition sociale-écologique par les économies de dépenses sociales réalisées au moyen de politiques environnementales ambitieuses visant à améliorer le bien-être humain, et d’abord la santé. C’est déjà en partie la logique économique de l’État providence dont l’efficacité est aussi grande que la justice : en corrigeant les inégalités sociales, en mutualisant les risques, en augmentant la productivité du travail par le développement de la santé et de l’éducation, l’État providence permet des économies considérables. De quel ordre financier ? On peut chiffrer précisément le coût économique de la non-mutualisation des dépenses de santé aux États-Unis : 8 points de PIB, soit ce qui sépare le coût du système de santé américain de celui des autres pays de l’OCDE, autrement dit 1 700 milliards de dollars (1500 milliards d’euros).
Ajoutons que l’État providence agit comme un réducteur du besoin de croissance économique, laquelle est réciproquement un ersatz aux politiques sociales. La raison pour laquelle les États-Unis ont structurellement besoin de bien plus de croissance des revenus que les États européens est lié au niveau des inégalités (les plus hauts revenus captant l’essentiel de la croissance, il en faut donc davantage pour les autres) et à la faiblesse des protections sociales (le coût de la santé et de l’éducation, du fait de leur caractère privé, nécessite des salaires plus élevés). Il n’y a donc aucun sens à comparer les taux de croissance (et les niveaux de vie) aux États-Unis et dans l’Union européenne sans les corriger de ces deux « trappes à croissance ».
L’ampleur de ces économies sociales sera encore plus conséquente sous l’effet de politiques environnementales ambitieuses qui nous permettront d’échapper à des chocs écologiques de la magnitude du Covid-19 ou de la canicule de 2003. Il est à cet égard grand temps de déplacer le débat du coût de la transition vers celui du coût de la non-transition. Combien en coûte-t-il aux finances sociales et plus largement publiques de ne pas prendre soin des écosystèmes, de la biodiversité, du climat ? La réduction de la pollution de l’air, qui pourrait épargner 100 000 vies par an en France, a ainsi des effets immédiats sur la baisse des dépenses sociales : on le voit avec les malades Covid dont la vulnérabilité est exacerbée par la qualité de l’air, sans parler des passages aux urgences saisonniers des enfants des métropoles françaises. De même pour le bruit et ses effets immédiats sur les pathologies cardio-vasculaires ou la qualité de l’alimentation. La transition sociale-écologique est un enjeu de long terme mais les économies qui en découlent peuvent être immédiates et seront d’autant plus grandes qu’elle est engagée tôt. Si, chaque année, aux urgences, à l’automne et en hiver, se présentaient dans les hôpitaux franciliens moins d’enfants atteints de troubles respiratoires, cela représenterait une économie nette pour les comptes publics (certes non comptabilisée par le PIB !), sommes que l’on pourrait par exemple allouer à la lutte contre l’isolement social, ce qui amoindrirait l’impact des canicules, particulièrement fréquentes et meurtrières en France.
La troisième et dernière stratégie, justement consiste à bâtir une véritable protection sociale-écologique de mutualisation des risques pour réduire les inégalités sociales et le coût économique qui en résulte[17]. Comme pour les régimes de retraite, la clé n’est pas la croissance du PIB mais les règles du système de protection sociale et les principes de justice qu’il mettra en jeu.
Terminons sur un point majeur : nous avons désormais la preuve que sortir de la croissance dans le siècle des chocs écologiques améliore le bien-être humain. Plutôt que de suivre le PIB comme l’a fait la France et perdre sur les trois tableaux économique, sanitaire et démocratique, la Nouvelle-Zélande s’est fiée à la boussole de la santé et a pu limiter ses pertes économiques, mais surtout préserver sa cohésion sociale. En sortant de la croissance, elle a sauvé des milliers de vie, fait des dizaines de milliards d’euros d’économie de dépenses sociales et renforcé les liens entre ses citoyens. En sortant de la croissance, les Néo-zélandais ont augmenté leur bien-être, leur résilience et leur soutenabilité.
[1] Wiedmann, T., Lenzen, M., Keyßer, L.T. et al. “Scientists’ warning on affluence”. Nat Commun 11, 3107 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-16941-y
[2] Telles que l’OCDE, le FMI, le PNUE, le PNUD, l’Agence européenne de l’environnement, etc.
[3] Indicateur qui inclut dans le calcul de la consommation des ressources naturelles les flux indirects (les ressources naturelles incorporées aux biens manufacturés) voir Thomas O. Wiedmann, Heinz Schandl, Manfred Lenzen, Daniel Moran, Sangwon Suh, James West, Keiichiro Kanemoto, “The material footprint of nations”, Proceedings of the National Academy of Sciences May 2015, 112 (20) 6271-6276.
[4] Eurostat, l’agence statistique européenne, a mis au point des indicateurs d‘efficacité matérielle. L’indicateur de référence européen est appelé productivité matérielle et divise le PIB par la CIM ou « consommation intérieure de matières » qui mesure la « quantité annuelle de matières premières extraites du territoire domestique de l’économie locale majorée de toutes les importations physiques et minorée des exportations ». On peut montrer, depuis 2000, que la CIM de l’Union européenne a diminué de plus de 9% tandis que le PIB a crû de plus de 30%, si bien que la productivité matérielle a augmenté de près de 40%. Une dynamique encourageante certes, mais on constate d’emblée que les trois quarts de la hausse de l’efficacité matérielle sont dus à la croissance du PIB et non à la baisse de la consommation des ressources naturelles et que cette baisse a été presque entièrement due à la grande récession de 2009. Qui plus est, l’indicateur de l’empreinte matérielle remet en cause cette dynamique vertueuse. L’empreinte écologique européenne ne fait en réalité que croître depuis 1990. Depuis 2000, on n’observe pas de découplage absolu entre PIB et consommation de ressources naturelles, mais au contraire un re-couplage : l’empreinte matérielle croît plus vite que le PIB à partir de 2002 (Éloi Laurent, 2020, « The European Green Deal: Bring back the new », OFCE Policy brief 63, January).
[5] Sur la notion de transition juste et le détail des politiques publiques qu’elle met en jeu, voir Laurent, É. (2020). « Introduction. La transition juste: Un nouvel âge de l’économie et de l’environnement », Revue de l’OFCE, 1(1), 5-20. https://doi.org/10.3917/reof.165.0005 et Éloi Laurent, « The European Green Deal: from growth strategy
to social-ecological transition?”, Social policy in the European Union: state of play 2020, 2021. https://www.etui.org/sites/default/files/2021-01/07-Chapter5-The%20European%20Green%20Deal.pdf
[6] Voir Laurent, Éloi. « Faut-il décourager le découplage ? », Revue de l’OFCE, vol. 120, no. 1, 2012, pp. 235-257.
[7] Avec 0 emploi net créé après 20% de croissance du PIB.
[8] E. Laurent, Sortir de la croissance – Mode d’emploi, Les liens qui libèrent, 2019.
[9] Employment growth and GDP in the euro area, Prepared by Vasco Botelho and António Dias da Silva, ECB Economic Bulletin, Issue 2/2019.
[10] La corrélation entre croissance du PIB et taux d’emploi est de 0,34 depuis 2012 pour les 37 pays de l’OCDE, voir How’s Life 2020, OCDE.
[11] Voir Et si la santé guidait le monde ? – L’espérance de vie vaut mieux que la croissance, Les liens qui libèrent, 2020.
[12] Sur tous ces points, voir à nouveau E. Laurent, Et si la santé guidait le monde ? – L’espérance de vie vaut mieux que la croissance, Les liens qui libèrent, 2020.
[13] E. Laurent, Sortir de la croissance – Mode d’emploi, Les liens qui libèrent, 2019.
[14] Voir E. Laurent, Et si la santé guidait le monde – L’espérance de vie vaut mieux que la croissance, Les liens qui libèrent, 2020.
[15] La corrélation entre PIB et revenu des ménages au cours des dix dernières années pour les 37 pays de l’OCDE est de 0,37.
[16] Tout en gardant comme objectif environnemental 55 euros la tonne de carbone en 2021 et en redistribuant 25% de ses revenus aux ménages en utilisant des dispositifs publics déjà existants, une majorité de ménages (plus de 50% des ménages dans les 6 premiers déciles de niveau de vie) bénéficieront financièrement de la taxation du carbone (recevant plus de transferts sociaux que ce qu’ils paient en taxe sur le carbone). Les 75% de revenus restants peuvent être alloués à la lutte contre la précarité énergétique, réduisant davantage les inégalités sociales. Voir Berry A. and Laurent E. (2019) « Taxe carbone, le retour, à quelles conditions? », Working paper
06/2019, Paris, Sciences Po, OFCE.
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/OFCEWP2019-06.pdf
[17] E. Laurent, « Construire une protection sociale-écologique : le cas de la France », à paraître, 2021.
Dr. Éloi Laurent est économiste senior à l’OFCE (Centre de recherches en économie de Sciences Po, Paris), professeur à l’École du management et de l’innovation de Sciences Po, à Ponts ParisTech et professeur invité à l’Université Stanford (Paris et Stanford). Macro-économiste de formation (doctorat), ses travaux portent sur la relation entre bien-être et soutenabilité, en particulier sur le lien soutenabilité-justice (l’approche sociale-écologique).
Illustration : W. Kandinsky, Délicate Tension, 1923
Cet article figure dans le second numéro de la Revue Germinal, mai 2021, « La République Écologique ». Découvrez-en le sommaire et l’édito : « La voie du socialisme écologique ».
Du même auteur :
E. Laurent, « Vers la pleine santé par l’État social-écologique », Revue Germinal, Octobre 2020
E. Laurent (dir.) The Well-being Transition. Analysis and Policy, Londres, Palgrave Macmillan, 2021
E. Laurent, Sortir de la croissance. Mode d’emploi, Paris, Les liens qui libèrent, 2021 (réed.)
E. Laurent, La métropole coopérative : éléments d’analyse et de mesure, Les Conférences POPSU, 2021.





